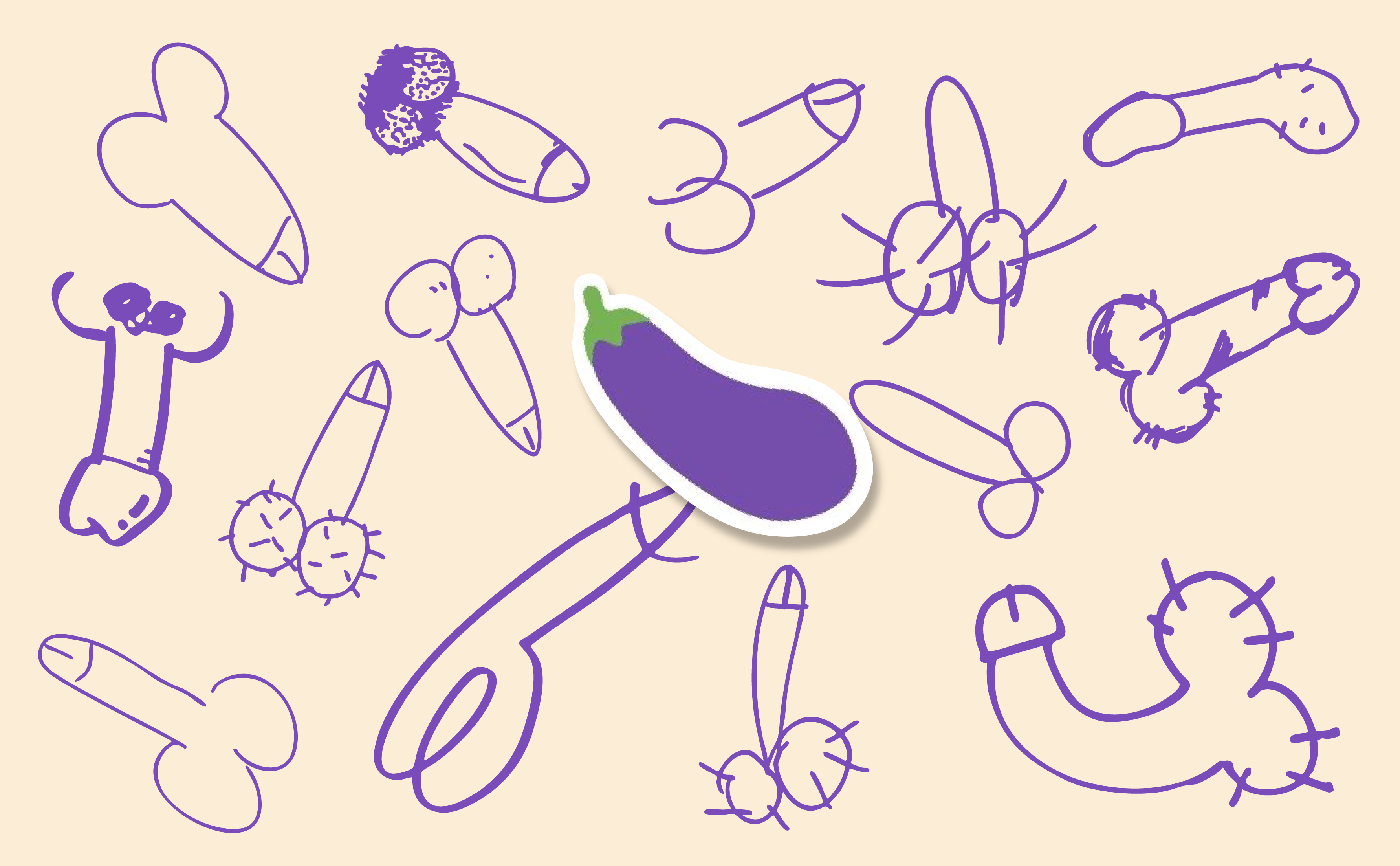
Parlons peu, parlons bite. Derrière le graffiti de chiottes se cache un totem visuel, symbolique, politique et culturel bien plus dense qu'il n'y paraît. Le pénis, ou plutôt son image, est partout, parfois envahissante, souvent banalisée : dans l'art, la rue, les campagnes de pub, la mode, les toilettes, les messages codés, les émoticônes... Il traverse les époques, se déforme, se cache, s'exhibe, s'érige, au gré des civilisations, des styles artistiques, des tabous, des libérations ou des censures.
La bite est invisible et pourtant omniprésente, grande phallocrate silencieuse de notre culture visuelle. Alors que les seins, les vulves et autres symboles du corps féminin connaissent depuis quelques années une relecture féministe et artistique, le sexe masculin reste, lui, prisonnier de sa charge symbolique, oscillant entre obscénité et toute-puissance.
Et si l'on décidait, une bonne fois pour toutes, d'analyser cet organe graphique malgré les interdits contemporains ? De décrypter les intentions, les détournements, les non-dits ? En 2018, Graphéine avait brisé les tabous en consacrant une histoire visuelle du sexe féminin. Laissez-nous cette fois-ci vous plonger dans la représentation du pénis à travers l'art, le design, la rue et les symboles.
L'objectif de cet article n'est pas de lister les zizis dans l'art (ça, Wikipédia le fait déjà très bien), mais de comprendre ce qu'on projette sur ce symbole visuel. Ce que notre époque dit de lui. Ce que sa représentation, aujourd'hui, provoque ou permet. Entre graffiti antiques et émoticônes suggestives, on propose ici une exploration graphique, sémiologique et sociale d'un organe devenu icône.
Le pénis à travers l’Histoire, des grottes aux gri-gris
Avant d'être graffiti sur les murs d'un lycée ou dessin moqué sur un urinoir, le phallus était déjà depuis fort fort longtemps un symbole fascinant et probablement protecteur ou sacré, à l’image du sexe féminin. Retrouvé gravé sur les parois des grottes de La Marche ou de Chauvet à l'époque du paléolithique sous toutes sortes de formes variées, on lui préférait pourtant les vulves, bien plus souvent représentées (d'après l’inventaire de Brigitte et Gilles Delluc). C’est pourtant l’exact opposé aujourd’hui où les pénis sont 10x plus présents dans l’espace public.
La vulve et le pénis sont ainsi probablement les premiers pictogrammes de l’humanité : on vous en parlait pour arte dans cet épisode du Dessous des images sur les pictogrammes des JO.
Du pilier hermaïque à Priape, les divinités bien membrées
Plus tard, dans la civilisation gréco-romaine, la représentation du pénis était loin d'être cachée : elle s'exposait, elle s'exaltait même. On trouve chez les Grecs à Athènes des piliers hermaïques, une borne en pierre à l'effigie d'Hermès qui se dresse dans le paysage urbain. Elle est ornée du buste du Dieu jusqu'à ses épaules, et d'un phallus dressé à mi-hauteur. Ces piliers balisaient les routes et les carrefours et protégeaient l'espace public, Hermès étant le Dieu des voyageurs et de la fertilité.
Le pénis y est frontal, assumé, jamais vulgaire. Il est signe de pouvoir, de virilité divine, de fertilité. À l'époque, on n'affichait pas un sexe pour le sexe : on signalait, on ordonnait, on sacralisait.
La bite avait même son Dieu : Priape, fils difforme d'Aphrodite et de Dionysos. Sa verge démesurée remplissait les trois fonctions de protection, fertilité et de comique, puisque Dieux et passants se moquaient de son infirmité. Divinité des jardins, les statuettes à son effigie effrayaient les oiseaux par sa protubérance. Dionysos lui-même était "né de la cuisse de Zeus", un ancien euphémisme pour indiquer le phallus de ce dernier...
On organisait d’ailleurs des phallophories pour le Dieu du vin et de la fertilité de la vigne : des processions dans lesquelles on portait un énorme phallus en bois. Un moyen original et un poil encombrant pour commémorer son démembrement par les titans à la suite duquel seul son "cœur" (comprendre ici son pénis) avait été retrouvé, puis mangé, avant de le faire renaître (Dionysos signifie "le deux fois né"). Cette histoire est héritée de celle d'Osiris.
Aujourd’hui, on trouve sur Etsy des pin’s reprenant ce motif...
Un peu d'étymologie fascinante avec le branding phallique
Symbole de fertilité, de pouvoir, de protection contre le mauvais œil, le phallus dans la Grèce antique était omniprésent et martelé tel un logo, un véritable branding sacré et fascinant s'étalant de l'architecture votive aux bijoux en passant par des fontaines ou des fresques de villas de marchands.
Les enfants n'y échappaient pas non plus puisqu'on leur attachait au cou des amulettes ornées de pénis ailés, les fascinum, pour les protéger du mauvais œil. Ces porte-bonheurs éloignaient des maléfices en incarnant ce membre protecteur, qu'on accrochait aussi à l'avant des chars victorieux... l'ancêtre des mascottes de voitures, en somme !
Fascinant, nous direz-vous ? Et vous aurez raison, puisque le terme "fascinant" vient justement de ces gri-gri phalliques, et signifie "utiliser le pouvoir du fascinus (qui désigne le phallus), pratiquer la magie, un enchantement". C'est le même sens ancien que celui des mascottes, mascoto qui signifie "envoûtement". Coïncidence ? Les mascottes de voitures servait-elles aussi à protéger du mauvais œil ?
Des noms d’oiseaux dans toutes les langues
Mais pourquoi des pénis ailés ? Le pénis et les ailes sont les attributs d'Hermès, messager des Dieux. Ce dernier parcourt librement les cieux, demeure des Dieux, et la terre, destinée aux humains, en liant les deux mondes. Il n'est peut-être pas si étonnant alors de noter que le pénis est souvent qualifié de noms d'oiseaux dans plusieurs langues. On l'appelle cock (coq) en américain, polla (poule) en espagnol, pinto (poussin) ou roula (colombe) en portugais, poulakis (petit oiseau) en grec, 屌 diao (oiseau) ou 雞 ji (poulet) en chinois…! Est-ce là un héritage gréco-romain ? En poussant encore plus loin, puisque rien ne nous arrête, pourrait-on dire que les avions, qui portent d'ailleurs aussi souvent des noms d'oiseaux : falcon, hawk, eagle... sont nos fascinum contemporains, des bites ailées qui traversent les cieux tel des messagers des Dieux modernes ?
Pour continuer dans cette lancée étymologique un peu capillo-tractée qui ramène tout aux phallus, le terme "branding" aurait la même racine que "brandir" (une arme) ou "branler" (faire bouger, agiter… à l'origine, une arme), on vous en parlait dans cet article.
Du Moyen-Âge à aujourd’hui, du sexe trivial au sexe caché
Au Moyen-Âge en Europe, la nudité n'était pas érotique, elle était triviale et on l'utilisait pour faire rire, punir, ou protéger. Difficile de comprendre le rôle descriptif, ironique ou banal de ces images dans notre civilisation actuelle si prude et sexualisée à la fois.
Le talisman protecteurs des pèlerines et pèlerins du Moyen-Âge
Les pèlerins et pèlerines du XIIe siècle portent des enseignes, des figures métalliques, qu'ils accrochent à leurs vêtements, sans aucune honte. Vulves couronnées, phallus de profil, coïts champêtres, verges ailées, vulves pèlerines à chapeau et bâton verge, ou vulves-fleurs sont autant de déclinaisons possibles. "Le désir de se préserver du mal ou d'écarter le mauvais œil s'est exprimé par des expédients aussi divers que l'insulte, l'amulette, la formule à prononcer ou le rituel collectif. Parmi ces moyens de protection, l'image a tenu une place importante en Occident et, parmi ces images, celles des organes sexuels ou de l'acte sexuel sont au premier rang des motifs protecteurs," nous raconte le livre Image et transgression au Moyen Âge.
Comme chez les Romains, "le sexe n'est qu'un motif parmi d'autres pour dissiper le mauvais sort ou protéger une zone. Il partage cette fonction avec les saints, la Vierge, le crucifix et des figures plus ambiguës que l'on retrouve sur certaines gargouilles. De telles images se retrouvent aux piliers d'entrée des bâtiments, aux portes, dans les manuscrits, comme les figures tutélaires des évangélistes et peut-être même certains monstres des marges." (Extrait tiré d’Image et transgression au Moyen Âge.)
On disait qu’un sexe féminin "chassait les démons, arrêtait les tempêtes ou, plus prosaïquement, détruisait, selon Pline, les insectes nuisibles," explique Claude Gaignebet. Ne bougez pas, on ramène l’anti-moustique.
Le sexe en marge
Les scribes n’hésitaient pas à tourner le pénis en dérision. On trouve dans les marges des manuscrits médiévaux, les marginalia, des pénis difformes, comiques, parfois armés, littéralement. Il existe tout un bestiaire sémantique où le sexe masculin devient objet d'absurde, de satire, de renversement, avec des dessins de femmes chevauchant des phallus géants comme des dragons, des nonnes en train de cueillir des testicules comme des pommes, ou des animaux mystères portant des couvre-chef en forme de verge. Voyez plutôt :
Dans ces manuscrits, les feuilles en vélin (parchemin en peau de veau) ou en peau de mouton valaient une couille (si vous nous passez l'expression) et écrire en gothique permettait un gain de place considérable pour condenser le texte sur les pages. Recopier des textes sacrés était un travail long et fastidieux, et les marges offraient un défouloir propice. Le pénis, donc, s'exilait hors du texte, là où les scriptes pouvaient lâcher la pression après plusieurs heures de calligraphie. Était-ce pour en rire ? Pour se protéger ? Pour se défouler dans cet univers chaste ?
Le chercheur Michael Camille évoque cette pornographie religieuse marginale comme une zone d'expression alternative, en dehors du dogme. Dans les marges, donc dans les interstices du pouvoir. Une sorte de contre-design sacré.
La naissance de la pornographie, grâce (?) à l'Église : interdire pour mieux montrer
Mais l'Europe médiévale chrétienne va progressivement invisibiliser les représentations du sexe vers le XVe siècle. Le pénis devient un tabou, une pulsion coupable, un objet de honte à mesure que l'Église Catholique se crispe sur le sujet. Le sexe est péché ; le phallus, une arme du diable, au même titre que la vulve d'ailleurs, organe de sorcellerie. Ce sent le roussi. "Leur lien avec la terre et le cosmos se rompt et elles se réduisent aux images naturalistes de l'érotisme banal, (...) où le bas corporel est amputé de sa dimension vitaliste" écrit M. Bakhtine.
Les hommes d'église jugent que ces représentations manquent de pudeur et "incitent à la débauche" comme le reproche Antonin, l'archevêque de Florence, vers 1450. "Tout ce qui touche au sexe et aux excréments, la « matière joyeuse », se trouve réduit à son pôle négatif par la morale." En glissant du sacré à l'érotisme, ces images ouvrent tout un nouveau champ visuel : la pornographie, avec les Ragionamenti de l'Arétin, vers 1534-1536, considérés comme le premier écrit dans ce domaine.
"En réduisant le sexe à son pôle sensuel et érotique, l'Église a permis la naissance de la pornographie" (Image et transgression au Moyen Âge) : qui l'eût cru ? Sans interdit, pas de transgression, sans transgression, pas d'érotisme !
Toutes les tentatives pour dissimuler, censurer ou supprimer une information aboutissent souvent au résultat opposé : l’objet caché devient beaucoup plus visible et attirant, précisément à cause de la tentative de dissimulation. On appelle ça l’effet Streisand.
Néanmoins, le pénis disparaît peu à peu des lieux publics et des tableaux ou s'y retrouve castré, dissimulé par un drapé, une feuille de vigne, une main pudique. Cette disparition physique donne lieu à une présence symbolique : on le sous-entend, on le devine, ou on l’interdit. C'est l'âge d'or de l'allusion graphique. L'architecture gothique, avec ses flèches pénétrantes et ses gargouilles lubriques, en dit souvent plus qu'elle ne montre.
Camoufler les pénis par des aubergines au XXIe siècle
Au XXIe siècle, le phallus continue de se cacher et se suggère grâce à un double digital : l'émoticône aubergine. Devenu langage codé pour le phallus, l’aubergine, la banane ou la carotte disent beaucoup de notre gêne à le nommer ou l’assumer. Omniprésente depuis toujours, la bite est invisible (sauf dans les dick pics) dans une grande hypocrisie générale. Ce tabou social est à son comble lorsque Google invente le projet "Quickdraw", une base de données de 50 millions de dessins numériques initiés par les utilisateurices, dans lequel cette forme iconique la plus vieille du monde n'est tout simplement jamais mentionnée ! "Et moi, et moi, et moi?" semble-t-il chanter.
En réponse, le studio Moniker a créé le site www.donotdrawapenis.com qui sert d’annexe pour compléter la collection en proposant aux gens de ne pas dessiner... des bites (pour souligner l'absurdité de la situation).
Là où le sein érotisé se bat pour ne plus l’être (voir le mouvement #FreeTheNipple), le pénis reste pixelisé, flouté, évité, ou remplacé dans les images. La prolifération des emoticônes phalliques montre néanmoins que si le besoin de représentation persiste, il mute. L’émoticône n'est plus un objet de puissance : c'est un clin d'œil, une ironie, un code qui n’est secret pour personne.
Si parler du sexe dérange, rend mal à l’aise, on a du mal à imaginer qu’il fut un temps pas si lointain où on en parlait sans vergogne, ou qu’il existe des pays qui en parlent librement. D’ailleurs, quelle idée d’écrire un article aussi long sur le sujet. Mais comme on dit; ce n’est pas la quantité, c’est la qualité qui compte. (Evitera-t-on pour autant la censure de Google ?)
Au Bhoutan : les phallus qui protègent
Toutes les cultures ne partagent pas la pudeur occidentale vis-à-vis du phallus. Les pays nordiques appellent un gland un gland, et n’ont pas de gêne à parler ou montrer des phallus. Au Bhoutan, royaume enclavé de l'Himalaya, le pénis est littéralement peint sur les murs. Grand, rose, flamboyant, souvent ailé, parfois crachant du feu ou du sperme. Loin de l'obscénité, ces représentations colorées sont des symboles de protection, hérités du moine Drukpa Kunley, surnommé "le fou divin", qui prônait un bouddhisme joyeux, irrévérencieux et très sexué. Il aurait ramené le Boudhisme du Tibet, et vaincu une démone avec son membre auquel on attribua le doux nom d'"éclair magique de la sagesse ».
Aujourd'hui, les femmes en quête de fertilité viennent se taper la tête avec un phallus en bois en faisant le tour du temple du moine. À la campagne, la tradition veut que l'on accroche cinq phallus aux quatre coins et au plafond des nouvelles maisons en guise de protection. Le phallus y est un talisman graphique, un mantra visuel contre les mauvais esprits.
Ces phallus bhoutanais sont standardisés mais uniques, peints à la main, à mi-chemin entre icône religieuse et sticker punk. On en trouve aussi en Thaïlande, ou à Bali.
Ils posent une question essentielle pour les cultures visuelles : où s'arrête l'obscène et où commence le sacré ? Pourrait-on encore, dans nos cultures aseptisées, imaginer une communication graphique aussi décomplexée, aussi puissamment locale ?
Bitologie urbaine : graffitis, tags et sexpression de la rue à la lune
Si le pénis s’affiche rarement ailleurs comme un organe sacré, il s’incarne universellement dans un symbole sauvage et furtif : le graffiti de bite, devenue une icône au fil du temps. Ce graffiti primitif traverse les cultures dans son érection perpétuelle, car rares sont les représentations "au repos".
Les têtes de bite de Pompéi
Au XVIe siècle à Rome, comme l'expliquent Coline Sunier et Charles Mazé dans leur excellente conférence Sex Symbols, on affichait des dessins de bites dans des cartelli infamanti, des posters diffamatoires pour injurier ses ennemis (cf image ci-dessous à gauche). Anonymes, ils étaient collés dans la rue à l'attention d'une personne en particulier, ou utilisés comme revendication. La diffamation étant considérée comme un crime, la police a gardé ces drôles de pièces à conviction dans des registres.
Mais nombreux étaient aussi les dessins de "têtes de bites", ces hommes à nez en forme de phallus, retrouvés sur les murs de Pompéi dès 79 après JC et que l'on dessine encore aujourd'hui sur les murs avec probablement autant de passion.
D'ailleurs, avez-vous remarqué que les verges romaines étaient presque exclusivement dessinées de profil ? Le dessin du pénis "vu du dessus" tel que l'on pratique aujourd'hui serait hérité des planches médicales qui découperont dès le XVIe siècle le sexe en tranches anatomiques (comme ci-dessous, tirées de la bibliothèque de l’Université Paris Cité). Qui dessine encore des pénis de profil ? On laisse aux plus avant-gardistes d’entre vous le soin de reprendre le flambeau.
Habiter et régner dans l’espace public aujourd’hui
En dessinant des pénis, on s'exprime bêtement/bestialement et l'on défie l'ordre graphique et social. Mais pourquoi cette obsession ? Le pénis tagué est-il une pulsion graphique et revendicatrice ou un marqueur de territoire ? Dans l'espace urbain le graffiti de bite est comme un cri de présence. Un marquer primitif pour dire « je suis là ». Le tag de bite est provocation, posture, gage d'appartenance ou d'exclusion. Et même parfois revendication.
Là où le graffiti politique cherche à dénoncer, le dessin de zizi cherche à troubler, à gêner, à passer le temps, à moquer, ou à rappeler la présence de cet attribut viril en violant l'espace public, en y insérant du privé, de l'intime. D'ailleurs, en réponse de cette provocation graphique, de nombreuses féministes taguent des vulves sur les murs, pour se réapproprier cet espace essentiellement masculin.
Ce symbole urbain incarne l’idée même du branding : le fait d'apposer une marque, brand, donc de communiquer à travers un signe visuel reconnaissable par tous. On dépose son blason sur un territoire conquis. On dépose son logo pour identifier sa marque. On dessine une bite sur un banc, un mur, une porte, pour habiter l’espace.
Et de Rome à Paris, le pénis de la street est presque toujours identique : deux testicules, une hampe, parfois quelques poils, rarement du talent.
Une petite bite pour l'homme, une grande bite pour l'humanité
Mais saviez-vous qu’on a aussi envoyé un graffiti de bite sur la lune ? En 1969, le sculpteur Frosty Myers insiste auprès de la NASA pour envoyer un "musée minuscule" sur la lune, avec les œuvres de six artistes : John Chamberlain, Forrest "Frosty" Myers, David Novros, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, et Andy Warhol. Sans réponse de la NASA, la puce est glissée clandestinement à bord d'un module lunaire d'Apollo 12. La NASA répondra en disant "S'il est vrai qu'ils ont réussi d'une manière clandestine, j'espère que les oeuvres sont ce qui se fait de mieux en terme d'art contemporain américain."
Le "Moon Museum" a la taille d'une carte sim, et Warhol a eu l'idée d'y dessiner... une bite. Pourquoi ? Peut-être justement parce que c'est LA quintessence de l'art populaire, la plus simple, la plus visible, la plus représentée, la plus absurde, et la plus osée... à une époque où certains états américains interdisaient encore l'homosexualité ? Dans la presse, le NY Times censure l’œuvre avec un pouce, en indiquant qu'il cache "la signature de l'artiste".
Néanmoins, c'est la consécration ultime pour ce tag de bite clandestin : devenir une œuvre d'art pour les extra-terrestres. En simplifiant sa forme graphique à l'extrême, le phallus redevient un pictogramme moderne, une icône universelle comme à la préhistoire. À la différence près que la verge incarne désormais la sacralisation profane de notre société patriarcale. On ne vénère plus le sexe parce qu’il est à l’origine du sacré de la vie, mais parce qu’il incarne la grandeur virile de l’homme, dans un culte inavoué et secret. Car au XXIe siècle, le pénis est le plus souvent censuré.
« Montrer le pénis tue la sexualité »
C’est peut-être pour contrer cet tendance qu’en 2015 le créateur Rick Owens a fait défiler des hommes dans des vêtements qui dévoilent leur sexe, inversant ainsi le principe de l’acte de se couvrir. Adam et Eve, honteux, ne cachent-il et elle pas leurs parties intimes à peine chassés du jardin d’Eden ? Un an plus tard, Rory Parnell Mooney dévoilera lui aussi sur le podium des zones intimes comme le téton ou le nombril. Mais suffit-il de dévoiler pour banaliser et désacraliser ? Ou au contraire est-ce que le fait d’encadrer ces parties accentue leur sacralisation profane ?
En montrant la chose, Owens expose et force le regard sur cette zone. Il s’explique ainsi : « la nudité est l’un des gestes le plus simple et le plus primitif, c’est l’effet coup de poing. C’est puissant». Et pourtant les papous de Nouvelle-Guinée, qui vivent presque nus et se contrefichent d’Adam et Eve, utilisent un étui pénien, appelé Koteka. Mais avec le défilé d’Owens ce n’est pas la nudité primitive qui est mise en avant, ni la puissance de cette dernière —puisqu’elle ne porte en elle aucune honte, aucun gêne et n’a rien à déconstruire ou prouver (contrairement à la nudité du modèle occidental) ; c’est juste notre malaise qui se focalise sur un morceau de chair bourré de symboliques que l’on aimerait déconstruire. Un geste suffisamment efficace pour désacraliser le sexe masculin ? C’est ce que pense Arnold van Geuns, un autre créateur, qui pense qu’en « agissant de la sorte, il (Owens) a tué, peut-être intentionnellement, la sexualité. »
Qu'il soit talisman en Himalaya, graffiti grivois à Paris ou caricature médiévale, le pénis s'impose comme l'un des grands absents-présents de notre culture graphique. Il apparaît là où on ne l'attend pas, comme l’icône d’un culte interdit, une ligne de fuite dans l'ordre visuel. Il fait peur, il fait rire, il fait parler. Car le pénis est un signe. Il s'écrit, il se représente, il s'interprète. Et comme tout signe, il a besoin de contextes, de regards, de relectures.
Dans notre culture visuelle saturée, il est temps d'en ré-interroger la place : non pour le censurer, ni pour l'idéaliser, mais pour le comprendre. L'enjeu n'est pas tant de le montrer que de saisir ce que sa représentation, ou son absence, dit de nous. Le pénis est un outil de branding comme un autre, un logo phallique dans l'alphabet social. Il appartient à l'histoire de l'image, et à son futur. Et s’il existait une représentation du pénis autrement qu'en blason de pouvoir ? C'est peut-être là que réside l'enjeu de demain : passer du phallus dessiné non pour dominer, mais pour dialoguer. Et pas seulement grâce à des aubergines.
Sources :
Claude Gaignebet, Art profane et religion populaire au Moyen Âge, Paris, PUF, 1985
Gil Bartholeyns, Pierre-Olivier Dittmar, Vincent Jolivet, Image et transgression au Moyen-Âge, PUF, 2008
Mikhaïl Bakhtine, L'Œuvre de François Rabelais
https://journals.openedition.org/mondesanciens/938
Joey Holder, I make dildos out of insect penises, Vice
Pourquoi les Grecs et les Romains vénéraient-ils le phallus ? The Conversation
Le phallus comme objet et véhicule d'humour dans la peinture de vases attique, Alexandre G Mitchel
Typo inclusive
Re-imaging Masculinity: The Sacred Masculine Archetype as Revealed in Four Cultural Artifacts, Smith, Drew Harrisson
Symboles phalliques
Le corps morcelé de Dionysos, Frédérique Ildefonce
Sex Symbols, Coline Sunier et Charles Mazé — et la conférence au Campus Fonderie de l'Image
Pour qui donc à Pompéi s’élevaient ces phallus ? — Le Monde