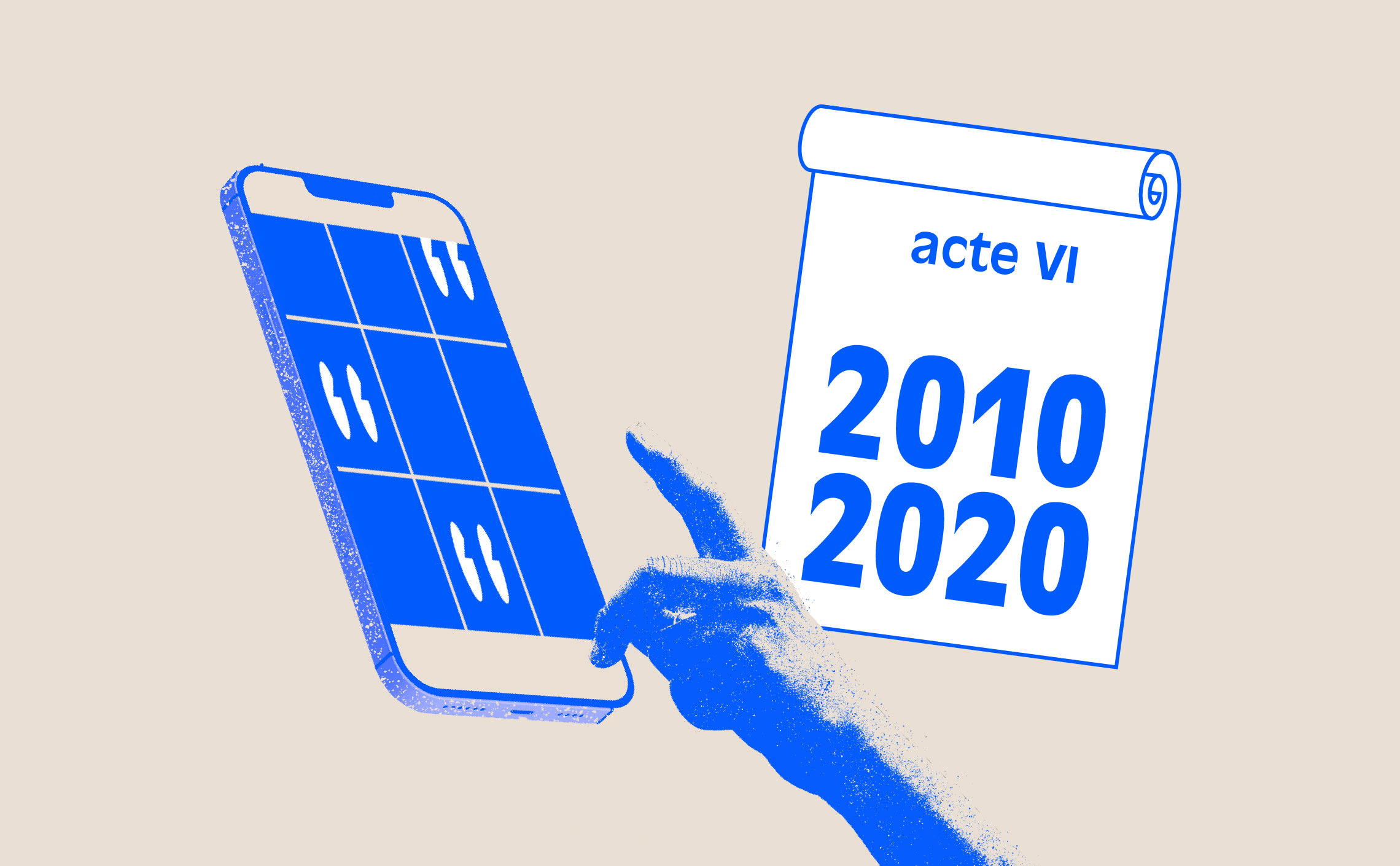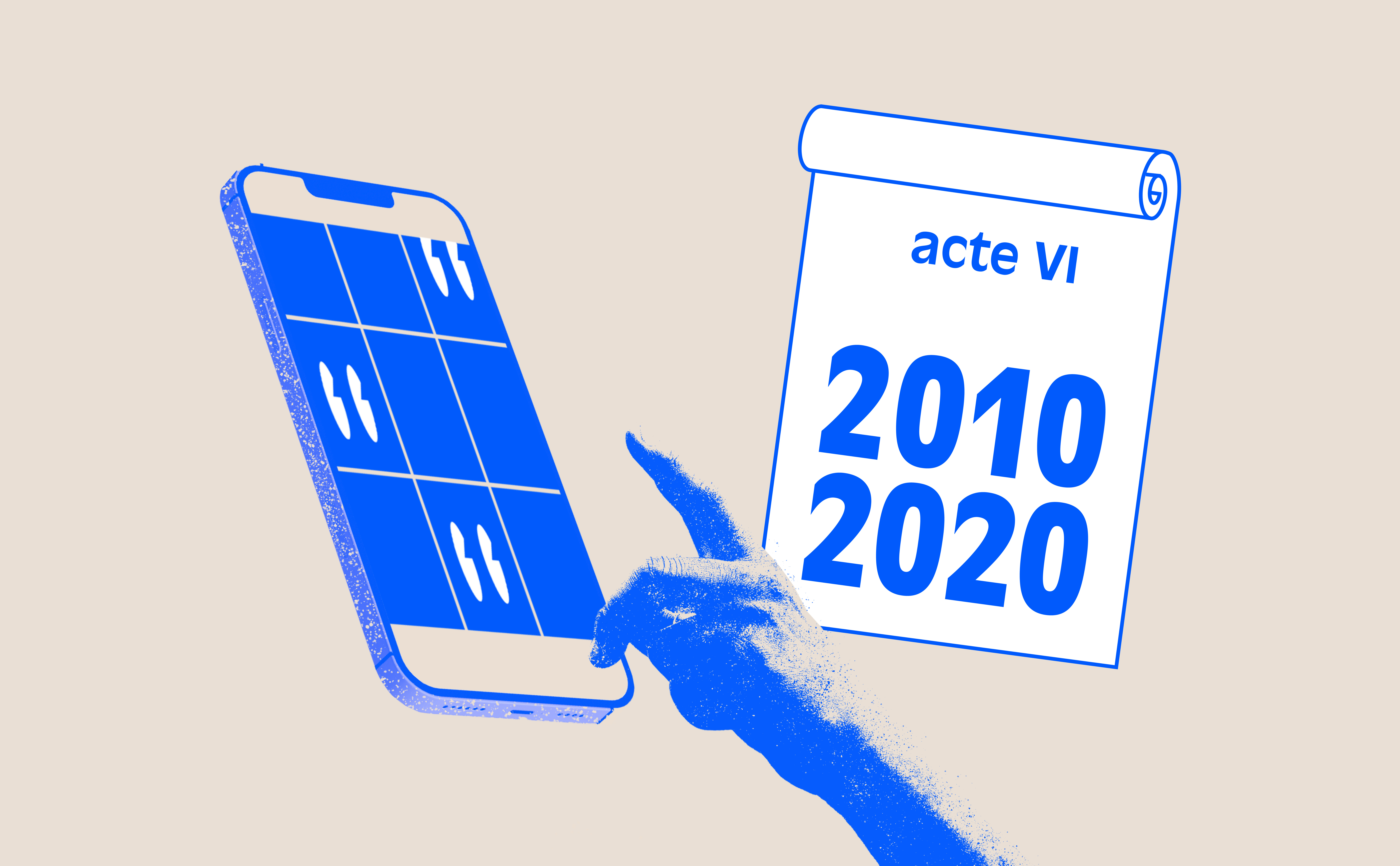
Cet article est le septième et dernier d’une série sur l’histoire de l’affiche de théâtre en France. Elle retrace l'origine des affiches de théâtre et leurs spécificités, miroir de notre société évoluant du tout texte à l'image, en passant par la création typographique et les supports numériques.
Déjà parus :
Préambule : Histoire de l'affiche de théâtre en 6 actes
ACTE I - L’âge d’or de l’affiche de théâtre au XIXe siècle
ACTE II - Les Trente Glorieuses 50/70
ACTE III - L’héritage de l’école polonaise et les années 70/80
ACTE IV - Les affiches du théâtre de la Colline, de Batory à l’atelier ter Bekke & Behage
ACTE V - L’intrusion de l’art contemporain
Durant ces 15 dernières années, l’affiche de théâtre s’est nourrie de toutes ces grandes tendances. De tous ces questionnements. Influences polonaises, dominantes typographiques, références à l’art contemporain, au statut de peintre affichiste. Le théâtre est devenu un acteur à part entière au même titre que l’auteur, le metteur en scène ou le graphiste.
À partir des années 2010-2015, les réseaux sociaux vont prendre une place incontournable dans la communication qui passe aujourd’hui par l’écran des smartphones... et beaucoup moins par les affiches.
Poésie, couleur, typographie et identité de l'affiche de théâtre
Un exemple avec Rudi Meyer ou Philippe Apeloig, pour le Théâtre du Châtelet. Chaque affiche est travaillée comme une création et ne répond pas à une logique de charte graphique définie en début de saison.
Au théâtre de la Comédie de Clermont-Ferrand, Fanette Mellier est venue apporter son savoir-faire de la couleur et du signe dans la ville. Auparavant, les créations du duo Antoine et Manuel animaient la communication de la Comédie.
M/M (Paris) poursuivent leurs créations d’auteur à part entière au Théâtre de Bretagne de Rennes.
Pour le théâtre national de la danse de Chaillot, Amélie Doistau trouvera un compromis image/typographie en utilisant les visuels des spectacles.
Pour le Ring, le théâtre Garonne et d’autres scènes culturelles de la région de Toulouse, Ronald Curchod aborde l’affiche en peintre affichiste. Il travaille avec une technique très particulière, la Tempéra à l’œuf.
Dans le domaine du théâtre privé, Pierre Jeanneau apportera une touche toute personnelle avec des affiches associant typographie. Un savant dosage pour obtenir des affiches accessibles au plus grand nombre.
Avec une logique encore plus épurée, Irma Boom, pour le Festival d’Aix-en-Provence, décline l’identité du festival sans autre visuel. C’était Brecht Evens qui “illustrait” auparavant les affiches. On est passé dans tous ces théâtres d’une personnalisation d’une pièce de théâtre à de la signalétique, parfaitement lisible et efficace, mais terriblement aseptisée. Une communication de marque.
Les années passées, c’est le Suisse Werner Jeker qui œuvrait à la communication du théâtre de l’Europe, Odéon.
Puis le duo ter Bekke & Behage qui suit Stéphane Braunschweig au théâtre de l’Europe, Odéon, où ils poursuivent avec méthode ce qu’ils avaient mis en place à la Colline.
En 2015, la Comédie Française, comme de nombreux théâtres publics, mettra sa programmation en retrait pour ne laisser qu’une cocarde rouge imposante facilement identifiable. La nouvelle identité visuelle ainsi que les affiches seront réalisées par C-Album. Encore et encore le théâtre en tant qu’institution.
Le théâtre de la Bastille fera le choix de la typographie et de l’abstraction graphique avec Marge Design.
Au Théâtre 71 de Malakoff, Brest, Brest, Brest, l’affirmation typographique renouvelle la communication visuelle des années passées.
À Aubervilliers, le Théâtre de la Commune collaborera avec le studio deValence avec des affiches renouant avec l’esprit dadaïste du début du XXe siècle. Un travail résolument typographique…
À la Colline, Pierre di Sciullo a mis en forme une touche plus poétique et libre avec ses systèmes d’écriture où il décline sa volonté de questionner le langage. Il n’avait jamais travaillé pour un théâtre de l’importance de la Colline.
Le Théâtre du Rond-Point a délaissé Atalante et les illustrations de Stephane Trapier qui le démarquaient des autres affiches culturelles au profit de visuels plus standardisés. Le logo de Gérard Garouste en décalage avec l’univers de l’identité visuelle théâtrale a lui aussi disparu.
ABM Studio (anciennement Labomatic) reviendra pour l’Opéra de Lyon ou le Théâtre de Lorient à des formes plus classiques, plus accessibles. Plus lisible pour un large public.
20 ans après les affiches de la Colline, Michal Batory reviendra sur le devant de la scène, pour le théâtre privé Elisabeth Czerczuk. Avec des affiches toujours percutantes au graphisme marqué.
Le théâtre du Châtelet réinvente son identité de marque aux côtés de l'agence bruxelloise Base Design, après une refonte de logo par nos soins. C’est un nouveau logo et un "nouveau monde graphique" que les spectateurs découvrent après plus de deux années de travaux et fermeture.
Après le décès brutal de Frédéric Teschner qui travaillait avec Lisa Sturacci, le Théâtre de Nanterre est venu chercher Paul Cox et son travail de peinture. Une façon peut-être de renouer avec cette tradition toute française du peintre affichiste ?
Et puis tant d’autres qui donnent de la diversité au monde du théâtre…
ÉPILOGUE - Et si le règne de la typographie était venu ?
L’histoire touche à fin, il est temps de conclure avec cet épilogue !
« Dans nos métiers, il y a trois personnes impliquées : le designer, le client et le public, aimait répéter Milton Glaser. Aucun des trois ne doit passer en premier, et surtout pas le designer. Au contraire c’est l’interrelation qu’il faut regarder, le narcissisme n’a pas sa place. L’égo ne devrait jamais être mal placé. » C’était il y a 50 ans, un demi-siècle et tout a été très vite dans l’univers de l’affiche de théâtre.
Jusque dans les années 90, l’affiche venait généralement mettre en image un spectacle. Et cette personnalisation s’appuyait sur l’écriture graphique de l’école polonaise d’après-guerre. La fracture apparaît avec Michel Batory à la Colline. Le théâtre a souhaité s’éloigner de l’image trop identifiée, devenue la signature de quelques graphistes auteurs.
Entre-temps, la révolution numérique est venue bouleverser en profondeur la communication. Il a fallu du temps pour que l’on perçoive que cette mutation n’avait pas uniquement impacté la création de visuels. Plus subtilement, ce sont les échanges entre les acteurs qui s’en est trouvée modifiée, c’est la relation commanditaire/graphiste qui est devenue autre. Dans un numéro d’Étapes (179), Evelyne ter Bekke & Dirk Behage reviennent sur ce glissement. « Depuis l’introduction des ordinateurs dans les années 1980, cette nouvelle technologie a rendu la relation entre les concepteurs et les commanditaires plus ambigus. Le “mythe” de la création s’est dégradé dans une relation plus ordinaire et démocratique. L’autorité professionnelle du concepteur graphique est souvent remise en question. Le concepteur doit plutôt “rendre un service”. La question aujourd’hui n’est plus de pouvoir imaginer des projets, mais plutôt de pouvoir les “bien” faire exister, tels qu’ils ont été imaginés. »
Ce qui est apparu à l’orée du XXIe siècle, c’est un quatrième personnage qui a pris une place de plus en plus importante… LE théâtre. L’affirmation de l’institution comme acteur créateur est visuellement devenue plus présente sur les affiches. L’institution, le théâtre et la programmation de saison s’imposèrent avec force. Le théâtre en tant qu’œuvre littéraire a quasi disparu au profit du théâtre lieu de spectacle vivant.
Graphistes typographes et affiches textuelles
Reste la question du couple texte/image qui, pour le coup, raconte aussi de notre société. L’affiche de théâtre a évolué vers des propositions où l’image s’est réduite à sa plus simple expression. À la place, la typographie ta pris une place hégémonique. Et paradoxalement, plus de deux siècles plus tard, nous retrouvons les affiches typographiques du début du XIXe siècle.
« Les graphistes sont devenus typographes ! » Annonçait déjà Peter Knapp il y a quelques années aux Rencontres de Lure.
Au point que certaines affiches peuvent être perçues comme des planches de spécimens typographiques telles que les fonderies en réalisaient pour communiquer sur leurs nouvelles créations. Des supports promotionnels qui s’adresseraient… aux graphistes !!! Est-ce à dire qu’aujourd’hui les affiches typographiques s’adressent avant tout au graphistes plutôt qu’au grand public ? « Moi, ce qui m’intéresse c’est de parler aux gens et pas de parler aux autres graphistes de mon milieu. » réagit Alain Le Quernec quand on lui demande ce qu’il pense de la production actuelle.
Alors oui, l’image pose question. Mais qu’en est-il de l’image et pourquoi ce nivellement typographique semble-t-il acquis ?
La culture du texte, et la prise de risque typographique
L’explosion des réseaux sociaux à partir de 2010, et plus particulièrement, l’apparition d’Instagram a modifié notre perception, notre rapport à l’image. Quelle que soit sa nature, l’image se retrouve massivement diffusée, mais aussi critiquée, montrée du doigt. Les polémiques deviennent alors très fréquentes.
Michel Bouvet l’exprime au regard de son expérience. « D’une manière globale, car ce ne sont pas uniquement les théâtres qui sont concernés, mais les institutions culturelles en général, depuis les années 2000, tout a énormément évolué et l’image est vraiment vécue comme une prise de risque. J’ai vécu l’âge d’or de l’affiche des années 80/90, où les commanditaires avaient envie de faire des affiches avec de belles images. Et puis on a connu un changement de génération. Et l’on a vu apparaître des gens sans doutes moins intéressés par l’image.
Et ce qui a commencé à se diffuser dans tous les domaines de la création, c’est la crainte permanente d’avoir des points de vue critiques sur les affiches. De se retrouver à devoir se justifier… “Qu’est-ce que ça représente et pourquoi ?” Je crois que j’ai toujours senti les limites à ne pas dépasser. J’ai fait des images qui ont suscité beaucoup de discussions, mais elles sont passées, je savais jusqu’où ne pas aller trop loin. Mais aujourd’hui, l’image est devenue beaucoup plus contestée qu’elle ne l’a été. Et la conséquence logique, pour pallier ces possibles débordements, c’est un glissement progressif vers la typographie.
Je continue à en proposer, je prends le risque de voir mon affiche refusée, peut-être moins par le client que par les afficheurs. Les affiches avec des images sont un appel très fort vers le public, cela suscite des envies, des vocations d’aller au théâtre. C’est l’occasion de parler des images, de s’en rappeler, de les mémoriser. Les affiches typographiques peuvent avoir de vraies qualités graphiques, et elles en ont, mais elles sont souvent moins repérables pour le grand public.
En 2020, j’ai été invité à Berlin pour un jury de sélection des 100 meilleures affiches allemandes, autrichiennes et suisses et déjà, j’avais fait ce constat… De nombreuses affiches étaient typographiques, il y avait très peu d’images. Alors que l’affiche allemande a été marquée historiquement par plusieurs générations d’affichistes remarquables. Depuis quelques années, il y a une vraie tendance à faire des affiches virtuoses. Ma question reste toujours la même : “Est-ce que ces affiches parlent au grand public ???”"
La bataille générationnelle de l'affiche
Sous un autre aspect, c’est aussi une histoire de génération. Encore aujourd’hui, l’image, dans l’affiche culturelle, est fortement liée à l’après mai 68 et les années Grapus. Des graphistes pour qui l’affiche se devait d’avoir du sens. Une génération qui partageait intellectuellement et politiquement l’état d’esprit des responsables institutionnels.
Malte Martin le vit au quotidien. « Qu’on le veuille ou non, je fais partie des designers graphiques qui sont sans doute liés à la production d’images que l’on a faites pour l’ancienne génération des dirigeants de théâtres. La nouvelle génération, et c’est légitime, est dans un désir de rupture avec cela. Une rupture d’écriture graphique, un besoin de marquer visuellement le changement de génération. Un directeur, une directrice de 35/40 ans, nouvellement nommée, appréhende souvent la collaboration avec un graphiste plus âgé qui a connu les lieux avant lui, le monde du théâtre et les codes de la communication. Et paradoxalement, l’expérience joue contre nous contrairement à d’autres champs de création. Ces nouveaux responsables font appel à de jeunes graphistes avec une forme de croyance que cela produira forcément l’image qui les représente en se distinguant de la génération d’avant. Mais peut-être aussi avec l’idée d’avoir une avance d’expérience et de légitimité pour rester les directeurs artistiques de la production visuelle.
Quand je travaille avec des urbanistes ou des architectes, je suis souvent le plus vieux et d’une certaine manière plus expérimenté qu’eux, et cela ne pose aucun problème, bien au contraire. Ils recherchent quelqu’un qui saura appréhender la complexité d’un problème urbain. Une approche très différente de celle d’un certain nombre de directrices et directeurs de théâtre qui espère de la visibilité avec une image originale. »
La typographie vient parfaitement répondre à ce “rapport de force”. Auparavant, un directeur de théâtre cherchait un graphiste capable de traduire visuellement le sens et l’esprit d’une pièce de théâtre. Et cela occasionnait souvent des frictions, des débats à chaque affiche. La typographie donne aujourd’hui l’illusion que l’on peut passer outre à ces subjectivités en adoptant un point de vue neutre.
Stephane Braunschweig pour le Théâtre de la Colline ne disait pas autre chose en souhaitant ainsi exclure l’image. Il précisait que l’affiche doit, par la typographie, rester neutre. « Le spectateur doit venir vierge dans la salle de spectacle ( !) » Une fois le système graphique mis en place, la déclinaison se réalise rapidement et sans discussion puisque sans surprise. Cela donne des lignes graphiques facilement prévisibles. Et sans risque.
Le théâtre comme une marque qui se fait remarquer
Le choix de la typographie répond aussi à de vraies raisons économiques. Car l’image est soumise au droit d’auteur à payer alors que les mots restent libres d’utilisation. De plus créer une image prend du temps, beaucoup de temps qu’une conception typographique. Cela parle d’un modèle économique qui a évolué depuis 40 ans. Les budgets de la culture se resserrent.
La nouvelle communication du Théâtre de Chaillot par Zoo designers graphiques nous offre d’autres pistes de réflexion. Depuis 10 ans, l’écran du smartphone lisse la production graphique. La taille même de l’écran incite à une utilisation plus grosse et plus grasse de la typographie. Tout doit-être immédiatement lisible. Ce sont les codes de la commerciale qui peut à peu s’imposent. Que Chaillot communique aujourd’hui comme Paypal (dans sa dernière campagne réalisée par Pentagram) en dit long sur ce nivellement.
Tout se ressemble et tout se confond, tout se vaut et les hiérarchies entre les domaines s’estompent. L’omniprésence du smartphone est venue uniformiser le message. Comment ne pas penser à la prévision de Mac Luhan, “Le message c’est le médium”… nous y sommes.
À Paris, le secteur du théâtre est vaste et fortement concurrentiel d’où la nécessité de se faire remarquer. D’avoir une visibilité forte. Avec la tentation d’user d’écritures graphiques agressives et impactantes. D’être dans une logique de communication de marque et non plus de produit. Il s’agit de dire très fort “Il se passe quelque chose à l’Odéon, à la Colline, à Chaillot”. Le temps n’est plus à la promotion de la “Mouette” de Tchekhov ou du “Soulier de Satin” de Claudel…
Le théâtre comme lieu institutionnel est véritablement devenu une marque. Il ne signe plus discrètement, dans un coin de l’affiche, il occupe toute la place. Toute la place. Et comme pour toutes marques, le théâtre public applique une logique marketing et publicitaire. On peut voir ici des tote bags de la Colline avec la recette du taboulé libanais de Wajdi Mouawad. Quel est le rapport avec le théâtre ? Aucun, si ce n'est que cela crée un lien émotionnel entre lea spectateurice/client.e qui s'approprie ces goodies et peut se préparer un bon taboulé à la maison après une sortie théâtre. On avait des hommes sandwichs au XIXe, on a aujourd'hui des hommes et femmes tote bags.
Le glissement s’est étalé sur 20 ans, imperceptiblement. Le Théâtre de la Colline est devenu La Colline. La marque Colline fait de l’ombre aux pièces en représentation qui, si l’on pousse la logique plus avant, peuvent être perçu comme des produits dérivés (oui, c’est excessif de le dire comme ça !!!).
Le théâtre, pour qui, pourquoi ?
Tous les théâtres se “battent” pour les mêmes abonnés de Télérama et dans une moindre mesure, des Inrockuptibles. Il faut, au-delà de l’attractivité de telle ou telle pièce de théâtre, être bien visible comme un lieu suffisamment séduisant pour être abonné. Car l’abonnement est la nouvelle priorité. Cela pousse à une communication qui valorise l’identité du lieu au détriment la programmation. La typographie seule ou la typo avec une photo de la pièce va vite s’imposer comme la meilleure réponse graphique, en tout cas la plus efficace pour parler de ce lieu.
Reste la question centrale qui est présente dès le début de cette histoire, pour qui communique-t-on ? À qui s’adresse-t-on pour dire quoi ? Quel public souhaite-t-on faire venir dans une salle de spectacle ? Cet été, dans une tribune de Libération, Ariane Mnouchkine, la fondatrice du Théâtre du Soleil, prenait position au moment des élections législatives anticipées.
« Qu’est-ce qu’on n’a pas fait ? Ou fait que nous n’aurions pas dû faire ? Je nous pense, en partie, responsables, nous, gens de gauche, nous, gens de culture. On a lâché le peuple, on n’a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu’ils voyaient, on leur disait qu’ils se trompaient, qu’ils ne voyaient pas ce qu’ils voyaient. Ce n’était qu’un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis, comme ils insistaient, on leur a dit qu’ils étaient des imbéciles, puis, comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. On a insulté un gros tiers de la France par manque d’imagination. L’imagination, c’est ce qui permet de se mettre à la place de l’Autre. Sans imagination, pas de compassion. Aujourd’hui, je ne suis pas certaine qu’une prise de parole collective des artistes soit utile ou productive. Une partie de nos concitoyens en ont marre de nous : marre de notre impuissance, de nos peurs, de notre narcissisme, de notre sectarisme, de nos dénis. J’en suis là. Une réflexion très sombre, incertaine et mouvante. »
Wajdi Mouawad, le directeur du théâtre de la Colline, fait figurer cette question frontale dans le programme de saison : Le théâtre pour qui, pour quoi ? Et toujours cette question du rôle du théâtre public, de sa mission. De l’importance de l’affiche de théâtre dans l’espace public.
De l'importance des affiches de théâtre
Une affiche de théâtre, c’est aujourd’hui encore une image qui va être vue des milliers de fois, des centaines de milliers de personnes vont passer devant. Au milieu d’autres affiches commerciales. Ce fut longtemps un support de lutte, de résistance et de combat contre l’hégémonie des messages publicitaires et des signes commerciaux dans la ville. Une affiche de théâtre peut arrêter notre regard, que l’on aille au spectacle ou pas. Une affiche de théâtre peut nous questionner.
On peut même considérer que l’affiche de théâtre participe à l’éducation à l’image. À la qualité visuelle de notre environnement. On parle souvent de nuisance sonore urbaine, très peu de nuisance visuelle. Il suffit de regarder à quoi ressemble l’entrée de certaines villes pour en être convaincu.
Cet été, Paris et plus largement la planète entière a vécu au rythme des Jeux Olympiques et de la ferveur que cela a suscité. Thomas Jolly, le directeur artistique de Paris 2024 revenait dans une interview du Monde sur l’engouement généralisé que tout le monde a découvert. Il posait, pour l’occasion, de vraies questions concernant le théâtre et son public.
« L’universalisme sort plus fort de ce dialogue entre le commun et le singulier. De même, l’association heureuse de la culture et du sport, deux ciments pour faire société. Les politiques devraient retenir cette leçon. Pourquoi n’y aurait-il pas une Coupe du monde de théâtre ? Elle a existé, autrefois, avec les Dionysies. Le théâtre se jouait dans des stades de 20 000 places, soit dix fois plus de spectateurs que dans les plus grands théâtres de France. Je ne dis pas qu’il faut toujours réunir sport et culture. Mais si ces cérémonies ont prouvé quelque chose, c’est que le spectacle vivant est porteur d’outils pour mieux être ensemble ».
“Le mieux vivre ensemble” “La culture pour le plus grand nombre”… Le débat reste d’une brûlante actualité. Car pour la première fois depuis de nombreuses années, les budgets de la culture semblent réellement menacés. Et c’est la place du théâtre, les missions du théâtre public, l’économie du théâtre qui se retrouvent sur le devant de la scène. À n’en pas douter, tout cela va nourrir la réflexion des responsables et des graphistes sur la nature de ce que doit être aujourd’hui l’affiche de théâtre.
Avant que le rideau ne tombe, une remarque de Paul Cox à propos de ses créations pour les Amandiers. « Mon souhait est de réussir l’équation suivante : image forte et reconnaissable d’année en année, mais surprise de la nouveauté à chaque saison – chacune étant, à son tour, considérée comme un récit, ou du moins réunie par une thématique. »
En 2025, nous avons plus que jamais besoin d’imaginaires narratifs et “d’affiches qui chantent tout haut”, comme décrites par Apollinaire dans Alcools !!!
____
Rédaction : François Chevret
Sources, pour aller plus loin :
En jaune et noir, 8 saisons. Théâtre Nanterre-Amandiers — Pyramid Éditions, 2010, Théâtre de la Colline
Interview Pierre Bernard — Formes Vives
Interview Gérard Paris-Clavel — Formes Vives
Étapes n°35 décembre 1997 — n°167 avril 2009 — n°179 avril 2010, Claude Baillargeon à l'affiche, novembre 2022
Histoire du graphisme en France, Michel Wlassikoff, Éditions les Arts décoratifs, Paris 2008
Les affiches qui ont marqué le monde, Michel Wlassikoff, Éditions Larousse, Paris 2019
Pologne, Une révolution graphique, Mois du graphisme d’Échirolles 2018, Éditions du Limonaire, 2018
Carnet d’affiches Carnets de voyages, Michel Bouvet, Éditions De visu l’image, Paris 1995
Un manuel du graphiste, Michel Bouver / Fanny Laffitte, Éditions Eyrolles, Paris 2022
Les formes comme des récits, Paul Cox au théâtre Nanterre-Amandiers
Jules Chéret — galerie 123
Michal Batory — Paris art
Michal Batory, artisan de l'affiche — Artefake
Le Chaillot de Jacno
Affiches politiques et culturelles, exposition BDIC
Pierre Di Sciullo : « Une bonne affiche existe sans vacarme » — France Culture
L’après-midi d’un phonème - Pierre Di Sciullo - ZEUG
À Montmartre avec Pierre di Sciullo — La survivance
Pierre Di Sciullo, Affiche La Colline, théâtre national. Mad Paris, 2018
Théâtre de l’Athénée - Malte Martin, La survivance
Le théâtre qui a un grain de beauté, Malte Martin - les Éditions de l’œil, Paris
Visite guidée : Dans l’atelier des graphistes Evelyn ter Bekke et Dirk Behage — Télérama
Alain le Quernec, DDABretagne
Jacno, Cinq lettres capitales ! — Grapheine
Pierre Bernard & Grapus, « graphisme d’utilité publique » — Grapheine
Comment tu ne connais pas Grapus, Léo favier — Éditions Spector Book, 2014
Amélie Doisteau pour Chaillot
L'affiche, estampe des murs au musée populaire de la rue — Gallica BNF
Vincent Perrottet