Acte V – L’intrusion de l’art contemporain

Cet article est le sixième d’une série sur l’histoire de l’affiche de théâtre en France. Elle retrace l'origine des affiches de théâtre et leurs spécificités, miroir de notre société évoluant du tout texte à l'image, en passant par la création typographique et les supports numériques.
Déjà parus :
Préambule : Histoire de l'affiche de théâtre en 6 actes
ACTE I - L’âge d’or de l’affiche de théâtre au XIXe siècle
ACTE II - Les Trente Glorieuses 50/70
ACTE III - L’héritage de l’école polonaise et les années 70/80
ACTE IV - Les affiches du théâtre de la Colline, de Batory à l’atelier ter Bekke & Behage
ACTE V - L’intrusion de l’art contemporain
ACTE VI - La décennie des réseaux sociaux et le règne typographique
Deux ans après le “coup de force” de Michal Batory au théâtre de la Colline, une nouvelle déflagration graphique plonge les spectateurs de Bretagne dans des questionnements sans fin. L’art contemporain fait son entrée fracassante dans l’affiche de théâtre.
M/M affiche pour le théâtre de Lorient

En 1996, l’auteur et metteur en scène Éric Vigner, à la tête du CCDB-Théâtre de Lorient, confie la communication du théâtre au duo M/M (Paris). Débute ainsi une collaboration de 20 ans avec la mise en place de ce qui va se révéler être un véritable laboratoire d’expérimentation graphique.
Michaël Amzalag et Mathias Augustyniak, les deux M et M, se sont rencontrés en 1989 à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Une époque où l’enseignement de l’ENSAD opposait deux grands courants. Le courant Grapus qui prônait un “graphisme d’utilité publique” politiquement engagé. Et le Style International, le fonctionnalisme suisse issu de l’école du Bauhaus incarné par Jean Widmer. Et pendant que les querelles de chapelles graphiques chercheront à faire table rase du passé, les deux futurs M/M (Paris) regarderont ailleurs, au-delà du champ habituellement réservé aux arts graphiques.
En 1992, ils se retrouvent et fondent M/M (Paris). C’est l’époque où Jack Lang, le ministre de la Culture, accorde une légitimité à des domaines artistiques auparavant considérés comme mineurs ou marginaux. Il promeut la mode, le graphisme et la bande dessinée au patrimoine français. Un moment de bascule dont M/M saura tirer partie. « Pour survivre et être compétitif avec les machines, affirme Mathias Augustyniak, un graphiste contemporain doit être auteur, penseur, poète, journaliste, philosophe…»
Au départ, les affiches pour le théâtre de Lorient vont largement déconcerter le public, car elles brisent les repères habituels. « Les affiches ont été violemment critiquées, car peu lisibles, peu compréhensibles », explique Éric Vigner. « Aujourd’hui, les spectateurs savent comment déchiffrer l’information… Au-delà de parler de la pièce, des images ou du texte, c’est une œuvre en soi qui porte une idée. »


Car ces affiches ne ressemblent en rien aux traditionnelles affiches que l’on voit sur les murs. Elles n’ont pas de lecture évidente, pas de hiérarchie comme les affiches publicitaires qui délivrent un message commercial. Les affiches de M/M (Paris) demandent du temps, rien n’est perceptible au premier abord. « Pour ces affiches, nous adoptons les règles de la tragédie classique : unité de lieu, de temps, d’action. Chaque affiche est construite autour d’une photo couleur faisant référence à de la photo documentaire et d’un titre en noir et blanc, généralement en typo manuscrite", explique Mathias Augustyniak.

Ils déplacent radicalement le statut attendu de l’auteur culturel, du graphiste, en élargissant les possibles. Ils ne se positionnent pas au service d’un client, mais font partie de l’œuvre, dans des rencontres entre experts, entre créateurs et souvent en contournant une demande. Cette position deviendra leur laboratoire critique. Ils créent ainsi leur “griffe”, leur marque. La transversalité qu’ils explorent peut déconcerter tant elle mixte tout au point de voir leur travail comme une carte blanche prenant la forme d’un journal de travail. Chaque affiche raconte quelque chose, à mi-chemin entre parcours professionnel et personnel. On peut même y retrouver des traces d’autres collaborations parallèles comme pour l’affiche de “Savannah Bay” de Marguerite Duras. On y découvre par exemple une photo du making-of de la pochette de l’album “Vespertine” avec Bjõrk photographiée par Inez van Lamsweerde. Un véritable marabout/bout de ficelle…

Cette collaboration M/M (Paris) / Théâtre de Lorient fait émerger une nouvelle image qui ne revendique aucun héritage de l’école polonaise, la “sacro-sainte” métaphore visuelle. Un siècle plus tard, c’est paradoxalement la figure de l’affichiste peintre Toulouse-Lautrec qui revient en force sur le devant de la scène. L’artiste plasticien prend le pas sur le graphiste. Ce que les M/M (Paris) vont mettre en place avec éclat va être poursuivi à Nanterre, au Théâtre Nanterre-Amandiers.
Théâtre de Nanterre-Amandiers, Labomatic
En 2003/2004, la première campagne réalisée par le collectif Labomatic pour le Théâtre Nanterre-Amandiers est d’emblée vécue comme une volonté clairement affichée de faire sortir le théâtre de l’univers visuel où il est enfermé depuis bientôt 50 ans. Tout comme pour M/M (Paris), c’est une nouvelle génération qui compte bien prendre ses distances avec les codes graphiques du théâtre de l’après-guerre.
Les différents membres du collectif (Pascal Béjean, Frédéric Bortolotti et Nicolas Ledoux ; puis dans un 2e temps (2009) Pascal Béjean et Nicolas Ledoux (sous le nom PBNL) n’ont pas d’expérience du théâtre. Et c’est vers le champ de l’art contemporain qu’ils vont faire glisser l’affiche de théâtre.
C’est à travers ce nouveau prisme jaune et noir, que les spectateurs vont découvrir les affiches du théâtre des Amandiers.

Pour cette première saison, Jean-Louis Martinelli, le directeur va retenir la formule la plus radicale présentée par Labomatic. Une proposition créée à partir d’un fonds iconographique d’images amateurs (Grore images), regroupées par un artiste (Philippe Maitresse), des images sans prétention artistique, ce que l’on appellerait aujourd’hui de la photographie brut. Des images trouvées. Une typographie normographe et une association de couleurs qui, pendant dix ans, va “marquer” les Amandiers, le jaune et le noir.
Une construction des plus basiques et neutre, une image sur laquelle on colle un post-it jaune d’informations pratiques. Neutralité des images qui ne sont qu’un support, neutralité de la typographie. Un point de vue conceptuel qui vient, une nouvelle fois, en rupture totale avec les codes habituels de l’affiche de théâtre. Et comme souvent en art contemporain, le plus anachronique, le plus décalé suscite la curiosité.

Au fil des saisons, le concept de départ va être décliné avec méthode. Autant dans l’approche visuelle que typographique. Les cartouches jaunes prenant plus de force au détriment de l’image. Avec toujours les mêmes objectifs. Priorité à l’identité globale du théâtre au détriment des spectacles. Chaque affiche va trouver sa cohérence dans un ensemble plus vaste.

Au cours des années, l’affiche va évoluer et l’image photographique disparaitra progressivement. Puis elle se radicalisera en aplat jaune, typo noir. Comme si Labomatic souhaitait “nettoyer” le regard du spectateur pour redécouvrir la photographie les saisons suivantes. 2007/2008, viendront les images du lieu théâtral, la scène, la salle, les coulisses. Avec toujours le marquage typographique noir sur fond jaune. Avec le Vendôme, un caractère on ne peut plus classique créé sous la direction de Roger Excoffon en 1952. Puis ce sera l’environnement du théâtre, Nanterre, la ville. Puis les tableaux du Louvre en 2009/2010, des archétypes de la peinture classique des 18 et 19e siècles. Sans chercher à illustrer une pièce par une peinture particulière. Des gros plans photographiques en noir et blanc, acteurs, metteurs en scène, auteurs. Le tout sur rond jaune.

Au fil des saisons, et passé l’effet de surprise, se posera malgré tout la question des choix visuels vidés de leur sens et de la référence à l’art contemporain permettant de tout justifier.
En 2011/2012, Labomatic optera pour des photos de journalisme décontextualisés. L’affiche pour “Oncle Vania”, par exemple, présente un portrait N&B de Thomas Sankara, qui fut président du Burkina-Faso et mourut assassiné le 15 octobre 1987. Une photo d’agence distribuée par l’AFP. “Oncle Vania” est une pièce de Tchekhov qui mélange le drame et le comique. Pourtant, le décalage souhaité et revendiqué devient difficile à appréhender. Et l’on sent que l’anachronisme aléatoire des rapprochements est une logique qui s’épuise avec le temps.

D’autant qu’en se rapprochant de l’art contemporain, une autre question d’actualité apparait avec insistance, celle du côté élitiste et parisien du théâtre public, un théâtre qui s’éloignerait de ses objectifs, à savoir ouvrir au plus grand nombre l’univers du spectacle vivant.
Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet et Malte Martin

“Notre mission publique commençait dans un couloir de métro, avant même d’aller dans le théâtre,” 2005. À la même époque, cette question des missions du théâtre public sera abordée sous un autre angle au Théâtre de l’Athénée. C’est par un projet Agrafmobile (un laboratoire expérimental de création) que l’Athénée contacte Malte Martin et son atelier “Écouter pour voir” en 2005.
« Nous sommes un théâtre qui travaille sur le texte, nous choisissons souvent les auteurs avant les metteurs en scène. Et le rapport au texte que vous développez peut nous correspondre, expliquera Dorothée Burillon, secrétaire générale de l’époque, à Malte Martin. « Nous sommes un théâtre public dans les beaux quartiers près de l’Opéra et nous rencontrons deux problèmes… Nous sommes localisés dans un carré géographique où il n’y a que des structures privées et l’on nous imagine un théâtre privé alors que l’on aimerait affirmer notre statut public. Et deuxièmement, nous avons un public acquis, qui, correspond, pour simplifier, au cercle des “abonnés de Télérama” et il nous faut renouveler ce public, aller vers un public plus jeune. Dernier point, notre budget est limité parce que nous sommes un théâtre hors statut. »

Rapidement, Malte Martin va opter pour une proposition retournant la hiérarchie habituelle de l’affiche de théâtre, titre/auteur/citation… Étapes après étapes, l’image de marque de l’Athénée va prendre forme. « On dit fortement quelque chose par la citation qui devient “la vedette” et puis, en plus petit, on indique les infos sur la programmation des pièces. »
Les propositions graphiques de Malte Martin arrivent au moment où les sites web des théâtres gagnent en visibilité, la communication ne passant plus nécessairement par l’affiche qui peut prendre une certaine autonomie.
Le deuxième point concernait le public. Parler à un nouveau public, plus jeune, pour qui la sacralisation du théâtre est un handicap. Malte Martin cherchera à ce que la forme graphique ait un côté direct, populaire et accessible. D’où l’idée d’emprunter la bulle à la culture pop de la bande dessinée. Et de traiter cela avec un environnement graphique assez constructiviste, un côté coup de poing pour saisir un passant du métro. Que le théâtre parle dans l’espace public. Que la priorité soit donnée à l’institution, au lieu même du théâtre alors que le spectacle se fait plus discret. Comme si l’identité visuelle du théâtre n’était plus le petit logo en haut de l’affiche, mais l’écriture graphique de l’ensemble du support.

Au-delà d’un public traditionnel de connaisseurs et d’abonnés du théâtre, le pari qui a été fait à l’Athénée et qui le distinguait des autres, était de dire “On veut indiquer par nos affiches que le théâtre n’est pas ce lieu qui parle d’une matière scolaire pour les BAC+5 ou qui raconte des histoires d’anciens rois et d’allégories grecs pour un public savant. Mais que le théâtre a un point de vue sur le monde d’aujourd’hui !” L’idée des citations littéraires et des slogans utilisés permettra de rebondir sur le débat public et ce, dans un couloir de métro.
« Cela montrait qu’un théâtre peut se mêler de l’actualité et de ce qui entoure les gens. Au-delà de l’affirmation de l’identité du théâtre, cela parlait de la mission publique d’un théâtre public qui pouvait donner à lire, donner à entendre un texte. Notre mission commençait dans un couloir de métro, avant même d’aller dans le théâtre. »
L’aventure de Malte Martin à l’Athénée a duré 15 ans, de 2006 à 2021.
La parenthèse Anette Lenz et Vincent Perrottet

Autre approche singulière qui, elle aussi pose la question des missions du théâtre public au début du XXIe siècle, celle d’Anette Lenz et de Vincent Perrottet. Leur collaboration étroite avec Joël Gunzburger, l’ancien directeur du théâtre d’Angoulême, de la Filature de Mulhouse et de L’Onde aujourd’hui, est un exemple de la richesse et de la diversité que le monde du théâtre peut entretenir avec le design graphique et son environnement.
En marge des grandes tendances qui semblent s’installer depuis une vingtaine d’années, Anette Lenz et Vincent Perrottet recherchent ce qu’ils appellent une “écriture de fonction”, c’est à dire adaptée et personnalisée à un commanditaire, un lieu, un public, une ville en particulier. Qu’en est-il du projet culturel du théâtre comme de son rapport à l’image, sujet aujourd’hui on ne peut plus sensible ? « Avec les commanditaires, il faut partager le sujet pour pouvoir partager les images, précise Vincent Perrottet. Ils nous cultivent sur leur domaine et nous les cultivons sur le nôtre. Lorsque la relation est bonne avec un commanditaire, le résultat est bon. Lorsque la relation n’est pas bonne, avec nous il n’y a pas de résultats, cela s’arrête avant. Personne ne nous fera faire de mauvaises images. »
Après une première collaboration en 1992 avec Vincent Perrottet pour le théâtre municipal de Rungis, Joël Gunzburger appellera Anette Lenz qui présentera un travail singulier ouvrant la porte à l’abstraction, ce qui était une orientation inédite en France. Puis ce sera le théâtre d’Angoulême en 2001 où le duo de graphistes se retrouvera et développera une écriture graphique questionnant avec force le rôle du théâtre dans le contexte urbain. En 2003/2004, ils travailleront des images de la ville et de ses habitants ainsi que du théâtre lui-même.


« C’est important de travailler avec un vrai contexte, avec des gens dans la ville, explique Anette Lenz. Il s’agit souvent d’aller au-delà de la commande, c’est-à-dire utiliser cette commande publique pour être présent dans la rue… Avec nos affiches, le schéma est différent de ceux qui viennent dans les musées, là, c’est notre travail qui vient vers eux. Se pose alors la question de l’espace du théâtre dans l’espace de la ville. Comment se situe-t-il et de quelle manière les gens vont être intégrés dans cet espace.
Il s’agit souvent de trouver une identité pour le théâtre beaucoup plus que de trouver une identité pour les pièces elles-mêmes. »


 Merci à Etienne Mineur pour ses photos de l'exposition d'Anette Lenz, au théâtre de l’Onde au Centre d’Art Vélizy-Villacoublay
Merci à Etienne Mineur pour ses photos de l'exposition d'Anette Lenz, au théâtre de l’Onde au Centre d’Art Vélizy-Villacoublay
Puis ce sera la Filature, Scène nationale de Mulhouse. Le théâtre est installé dans un ancien bâtiment de filature… Une idée de tissage, métissage, maillage du territoire qui trouvera un écho graphique dans les affiches.
En parallèle, c’est à Chaumont au Nouveau Reflex qu’Anette Lenz et Vincent Perrottet vont encore surprendre en développant un projet sur un autre champ. Loin d’une forme d’abstraction et d’une écriture conceptuelle, ils vont travailler en immersion dans la ville au contact des habitants, des associations sportives et culturelles. Et réaliser, par exemple, des mises en scène de personnes grimaçants pour l’occasion. Retrouvant ainsi les origines du théâtre de rue où spectateurs et acteurs étaient en proximité. Une approche directe et populaire cherchant à créer du lien.
Dans notre dernier article, le VIe acte, nous parlerons de la décennie des réseaux sociaux et du règne typographique.
____
Rédaction : François Chevret
Partager cet article :



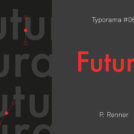
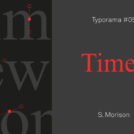
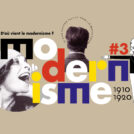
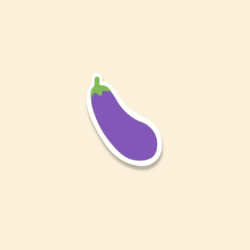 Ériger l’image du pénis : anatomie d’un symbole iconique
Ériger l’image du pénis : anatomie d’un symbole iconique Acte VI – La décennie des réseaux sociaux et le règne typographique
Acte VI – La décennie des réseaux sociaux et le règne typographique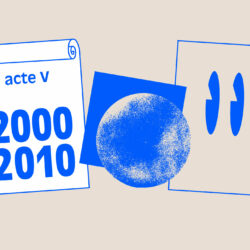 Acte V – L’intrusion de l’art contemporain
Acte V – L’intrusion de l’art contemporain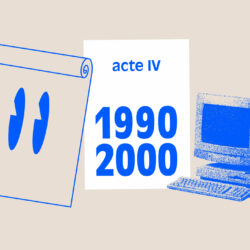 ACTE IV – Les affiches du théâtre de la Colline, de Batory à l’atelier ter Bekke & Behage
ACTE IV – Les affiches du théâtre de la Colline, de Batory à l’atelier ter Bekke & Behage ACTE III – L’héritage de l’école polonaise et les années 70/80
ACTE III – L’héritage de l’école polonaise et les années 70/80 Paris Parcours Sportifs – Signalétique
Paris Parcours Sportifs – Signalétique Skaal, le service immobilier 360° – Identité Visuelle
Skaal, le service immobilier 360° – Identité Visuelle Université Paris Cité – Identité visuelle
Université Paris Cité – Identité visuelle UNAF, Union Nationale des Associations Familiales – Identité visuelle
UNAF, Union Nationale des Associations Familiales – Identité visuelle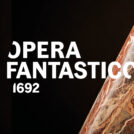 Opéra Fantastico – Identité visuelle
Opéra Fantastico – Identité visuelle Branding et colorimétrie : La stratégie du « RVB First » ?
Branding et colorimétrie : La stratégie du « RVB First » ?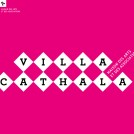 Charte graphique Villa Cathala
Charte graphique Villa Cathala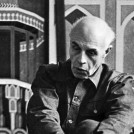 Edward Bawden, illustre illustrateur de grande Bretagne
Edward Bawden, illustre illustrateur de grande Bretagne Journées Portes Ouvertes UPEC
Journées Portes Ouvertes UPEC McDonalds change de nom et de logo en Russie
McDonalds change de nom et de logo en Russie
Hello, le lien vers l’acte IV est mort sur le sommaire de cet article.
Merci beaucoup pour votre travail, c’est passionnant comme sujet 😍